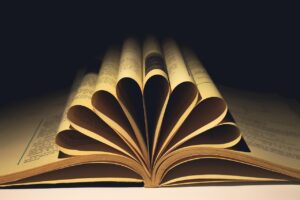« La plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. »
Dans sa lettre à Voltaire du 18 août 1756, Jean-Jacques Rousseau réfutait l’idée selon laquelle les risques seraient l’œuvre d’une Providence à laquelle il faudrait se soumettre. Il affirmait au contraire la responsabilité humaine — et, par conséquent, sa capacité à prévenir et à réparer les catastrophes. Cette réflexion, formulée après le tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 1755, préfigure déjà les approches modernes de maîtrise du risque. Elle vient également nuancer la thèse du sociologue allemand Ulrich Beck sur la « modernité réflexive », selon laquelle la reconnaissance du caractère fabriqué des risques — c’est-à-dire produits par les activités humaines — est une caractéristique propre à la modernité avancée.
Traditionnellement, les révolutions industrielles sont présentées à travers le couplage entre nouvelles sources d’énergie et nouveaux modes de transport : vapeur et train, hydrocarbures et automobile, aviation et kérosène. Aujourd’hui, nous assistons à l’émergence d’un nouveau tandem : les énergies renouvelables (qui ne sont pas si nouvelles, en réalité) et le transport de données numériques. Cette mise en réseau d’équipements interconnectés pour une production d’énergie distribuée fait apparaître de nouveaux risques : dispersion des sites difficiles à sécuriser, hostilité locale, vulnérabilité accrue aux attaques cyber…
C’est dans ce contexte que les étudiants de 2ᵉ année STPI et de 3ᵉ année GSI, issus des deux campus, ont participé à un exercice de simulation de crise au cœur d’un parc éolien. Répartis en équipes pluridisciplinaires (DSI, responsable IT, responsable communication, responsable juridique et financier, ingénieur en production électrique), ils ont dû gérer un scénario d’attaque combinant incendie criminel et cyberattaque, le tout orchestré par des groupes activistes opérant depuis l’étranger.
Cet exercice s’inspire d’un événement réel : l’attaque ayant visé une cinquantaine de sites éoliens en France et en Europe le 24 février 2022, au moment de l’invasion de l’Ukraine. L’un des objectifs était de familiariser les étudiants avec une approche systémique du risque, en les confrontant à des dimensions à la fois techniques, humaines, organisationnelles et géopolitiques :
• risque numérique,
• risque incendie,
• risque réputationnel (gestion du mécontentement des clients),
• risque environnemental (pollutions liées à l’incendie),
• risque géopolitique (ciblage d’infrastructures énergétiques dans les guerres hybrides).
Après deux séances de travail intense, les étudiants ont mobilisé leurs compétences analytiques et rédactionnelles pour produire un rapport de diagnostic et de recommandations, visant à réduire la fréquence et la gravité de tels incidents à l’avenir. Franck Gauttron, Hervé Duclos et Lucie Baudou ont co-construit ce scénario sous ses aspects techniques et narratifs en l’enrichissant de leurs champs d’expertise et de leur volonté d’activer des formes de pédagogies favorisant la collaboration et le décloisonnement des savoirs. Nous ne pouvons que constater que cet exercice fut aussi enrichissant pour les étudiants que pour les enseignants !